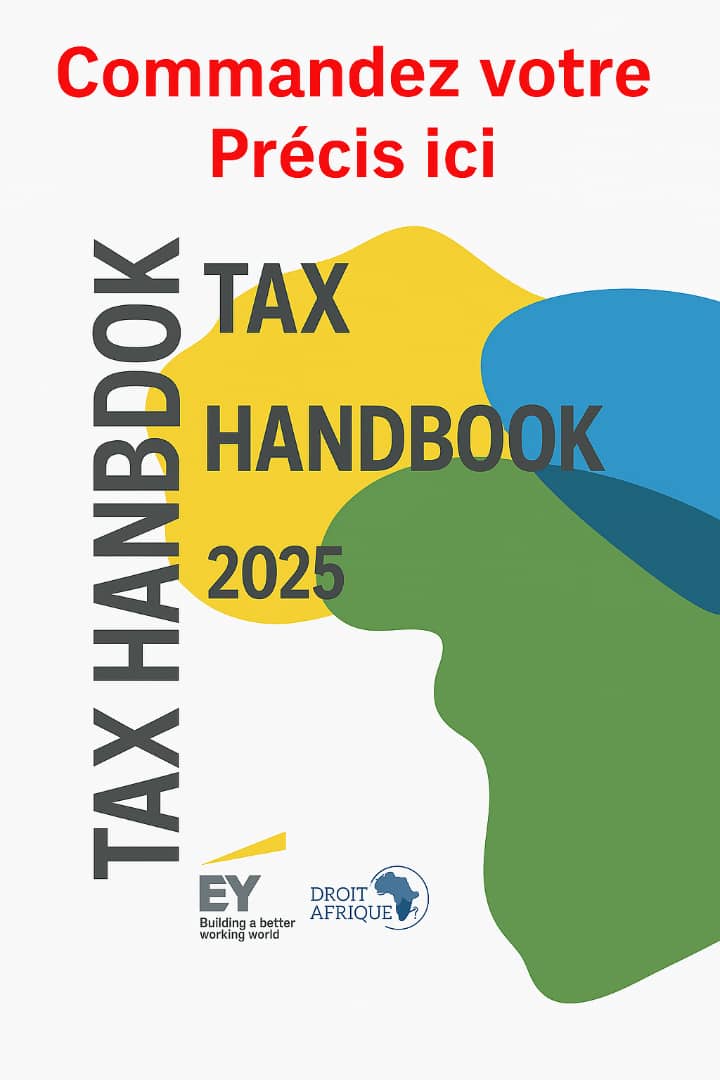Libreville, le 14 novembre 2025 – (Dépêches 241). Le pouvoir exercé par le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, pourtant né sous les auspices solennels d’une Transition qui promettait rupture, assainissement et renaissance institutionnelle, dévoile aujourd’hui une fragilité presque touchante. À observer la gestion du dossier judiciaire de l’ancienne famille présidentielle, il devient difficile de ne pas reconnaître un certain penchant pour la justice sélective, cette discipline subtile consistant à viser juste, mais jamais trop loin, et surtout jamais trop haut. En somme, une démonstration délicate de rigueur qui, curieusement, s’arrête toujours à deux doigts du cœur du système.
Qu’il est fascinant, pour ne pas dire savoureux, de constater que les poursuites s’abattent avec une vigueur exemplaire sur l’épouse et le fils d’Ali Bongo, tandis que ce dernier, qui fut tout de même Chef de l’État pendant quatorze ans, semble bénéficier d’une discrète et chaleureuse immunité de fait. Il faut croire que, durant cette longue période, Ali Bongo n’aura été que le spectateur involontaire d’un Gouvernement qu’il dirigeait pourtant. Une sorte de Chef d’État théorique, décoratif, presque symbolique. À ce stade, le nouveau régime ne se contente plus d’éviter d’engager des poursuites: il construit soigneusement l’idée que l’ancien Président, pourtant garant suprême de l’appareil politique, n’a jamais eu voix au chapitre dans la gestion calamiteuse de la République pendant 14 ans. Une révélation qui fera sans doute trembler les historiens.
Mais le récit devient véritablement jubilatoire lorsqu’on observe la fiction politique qu’on semble vouloir imposer: celle où Sylvia et Noureddin Bongo Valentin auraient été les seuls stratèges, les seuls cerveaux, les seuls génies maléfiques de quatorze années de gestion approximative. Une parabole à peine croyable, qui voudrait nous faire admettre que « Saint » Ali Bongo aurait passé son règne à signer des décrets les yeux fermés, à inaugurer des projets et à découvrir, stupéfait, les détournements commis dans son propre Palais. Un souverain innocent, entouré de créatures démoniaques dont il ne soupçonnait rien. À ce niveau, ce n’est plus de la politique : c’est de la littérature mystique.
Et, avec un peu de sérieux: un pays ne se gouverne pas en ménage, ni même en comité restreint familial. Il se dirige avec un Gouvernement, une administration, des ministres, des Directeurs Généraux, des ordonnateurs de crédits, des comptables publics, une armée, des technocrates… bref, avec tout un monde qui, visiblement, continue de fonctionner comme si de rien n’était. La justice, elle, préfère concentrer son énergie sur deux figures emblématiques, pratiques, efficaces, et surtout sans risque. Le pouvoir en place, en évitant soigneusement de remonter la chaîne des responsabilités, donne l’impression de ménager d’anciens compagnons devenus indispensables à sa propre stabilité. Une continuité que même les plus sceptiques finissent par trouver frappante.
La cerise sur le gâteau reste toutefois ce statut quasi religieux que la démarche actuelle confère à Ali Bongo. En l’exonérant de toute responsabilité, on le hisse dans une sphère à part, presque céleste : ni fautif, ni cité, ni même interrogé. On dirait une figure sacrée, immaculée par prescription tacite, dont les fautes auraient été miraculeusement absorbées par son entourage. Une posture qui ferait presque de lui un martyr administratif, un Saint républicain que l’on vénère en silence. À ce rythme, l’on pourrait bientôt instituer « Saint Ali », protecteur des chefs d’État responsables de tout mais coupables de rien.
Et que dire de l’absence totale de poursuites contre les autres acteurs qui, pourtant, signaient, validaient, géraient, réglaient, et parfois détournaient l’argent public à grande échelle ? Cette omission persistante ne renforce pas seulement l’incohérence : elle la transforme en dogme. Une justice véritablement déterminée aurait examiné le rôle de tous les acteurs de l’ancien régime, y compris ceux qui occupent encore des postes clés dans l’administration et qui, visiblement, dorment sur leurs deux oreilles. Le régime militaire, lui, semble préférer le confort d’une indignation ciblée à la rigueur d’une réforme authentique.
En définitive, ce manque de courage politique face à la vérité historique et judiciaire ne peut que nourrir la défiance populaire, en dépit de l’enthousiasme contrôlé d’une jeunesse mobilisée à la demande et de quelques voix de la société civile triées sur le volet. Pour restaurer l’État, il faudrait une justice lucide, impartiale, cohérente, capable d’examiner toutes les responsabilités sans frissonner devant certains noms. Mais tant que le spectre d’Ali Bongo continuera à hanter silencieusement les sphères du pouvoir, respecté comme un tabou politique et protégé comme une relique précieuse, la rupture restera ce qu’elle est devenue : un slogan admirablement prononcé, mais soigneusement contourné.