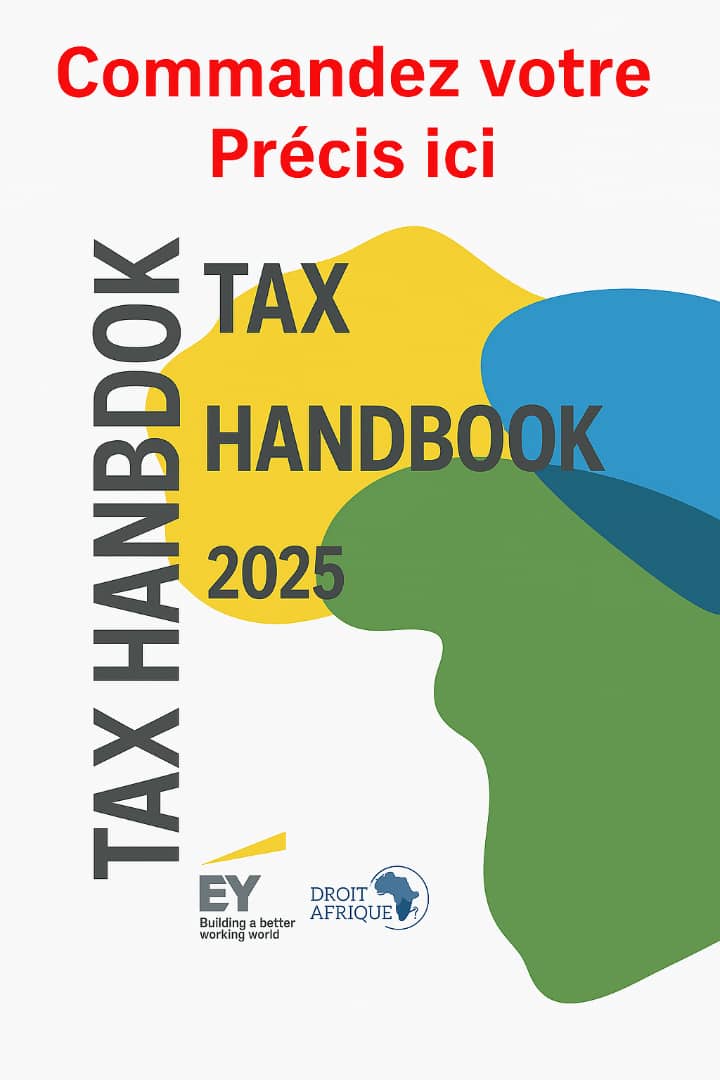Libreville, le 1er octobre 2025 – (Dépêches 241). Par-delà les apparences et les récits soigneusement construits, l’histoire récente du Gabon impose un devoir de lucidité. Le 30 août 2023, au lendemain d’un scrutin présidentiel entaché d’irrégularités manifestes, les militaires prenaient le pouvoir par la force, arguant de leur volonté de mettre fin à des décennies de manipulation électorale, de confiscation de l’État de droit et de convulsion démocratique. Ce coup d’État, unanimement qualifié de « salutaire » et même grossièrement appelé « coup de Libération » par une frange de la population, fut présenté comme un acte de rupture, un sursaut patriotique face à l’humiliation institutionnalisée du suffrage universel.
L’argumentation du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) était claire : les élections avaient été truquées, la souveraineté populaire bafouée, et le régime en place n’était plus légitime. Ainsi justifié, ce coup de force semblait, à défaut d’être conforme au droit, répondre à une exigence morale : celle de restaurer la vérité des urnes et de rétablir la dignité d’un peuple piétiné et privé de son droit de choisir librement et démocratiquement ses dirigeants.
Or, deux ans plus tard, l’indignation laisse place à l’amertume. Le scrutin local et législatif du 27 septembre 2025, organisé sous l’égide du nouveau pouvoir, a cruellement ravivé les souvenirs du passé honni. Partout, des pratiques que l’on croyait reléguées aux pages sombres de l’histoire politique gabonaise ont resurgi : fraudes massives, irrégularités flagrantes, violations répétées des textes électoraux, transport des électeurs, absence de transparence dans le dépouillement. La même mécanique, les mêmes méthodes, les mêmes résultats.
Comment, alors, ne pas s’interroger sur la cohérence du projet porté par les nouvelles autorités ? Comment concilier le discours inaugural de rupture avec la persistance, voire la réhabilitation, des vieilles pratiques du régime déposé ? Peut-on, sans cynisme, dénoncer hier ce que l’on cautionne aujourd’hui ? Il est pour le moins paradoxal, et profondément inquiétant, que ceux qui ont pris le pouvoir au nom de l’intégrité électorale se montrent désormais si accommodants face à la fraude, à la violation de la loi et à l’érosion de notre démocratie quand ils ne sont pas complices ou acteurs actifs.
Ce constat, brutal mais nécessaire, jette une ombre lourde sur la crédibilité du régime de Transition. Loin de rompre avec les travers du passé, il semble s’en faire le continuateur. Et cette posture alimente une impression grandissante d’imposture : celle d’un pouvoir qui, après avoir invoqué le peuple pour justifier sa prise d’armes, gouverne aujourd’hui en méprisant les principes mêmes qu’il avait juré de défendre.
Dès lors, une question s’impose, à la fois morale et politique : pourquoi avoir fait ce coup d’État, si ce n’est que pour reproduire ce qui était censé être combattu ? Pourquoi mobiliser l’espérance collective, au prix d’un acte aussi grave que la suspension de l’ordre constitutionnel, pour, in fine, reproduire les tares systémiques qui ont miné, détruit et corrompu la confiance citoyenne ?
À l’évidence, il ne s’agit plus seulement de déception. Il s’agit de responsabilité. Une responsabilité devant l’histoire, devant le peuple gabonais, et devant les institutions qu’on prétend restaurer. Car au fond, la question n’est pas de savoir si l’ancien régime était coupable, nul n’en doute, mais si le nouveau mérite encore le bénéfice de la confiance.
À travers ce retour brutal aux dérives électorales, c’est l’ensemble du récit fondateur de la Transition qui vacille. C’est l’esprit du coup de Libération qui s’en voit perverti. Les promesses se consument, les espoirs s’effilochent, et les masques tombent. Il ne reste alors qu’une évidence, cruelle : on ne libère pas un peuple pour mieux l’enchaîner à nouveau. On ne libère pas un peuple pour le diriger en ravivant les blessures toujours béantes du passé en exposant à sa vue et en premier plan, les figures du régime que l’on a supposément déposé.
En définitive, si les armes ont été brandies au nom du peuple, il est temps que le pouvoir se rappelle qu’elles n’en font pas une légitimité en soi. Celle-ci ne peut naître que d’un acte simple, mais exigeant : le respect sincère et scrupuleux de la volonté populaire. À défaut, ce qui devait être une Transition historique risque de n’être qu’une parenthèse de plus dans le long feuilleton de la confiscation du pouvoir et de trahison.