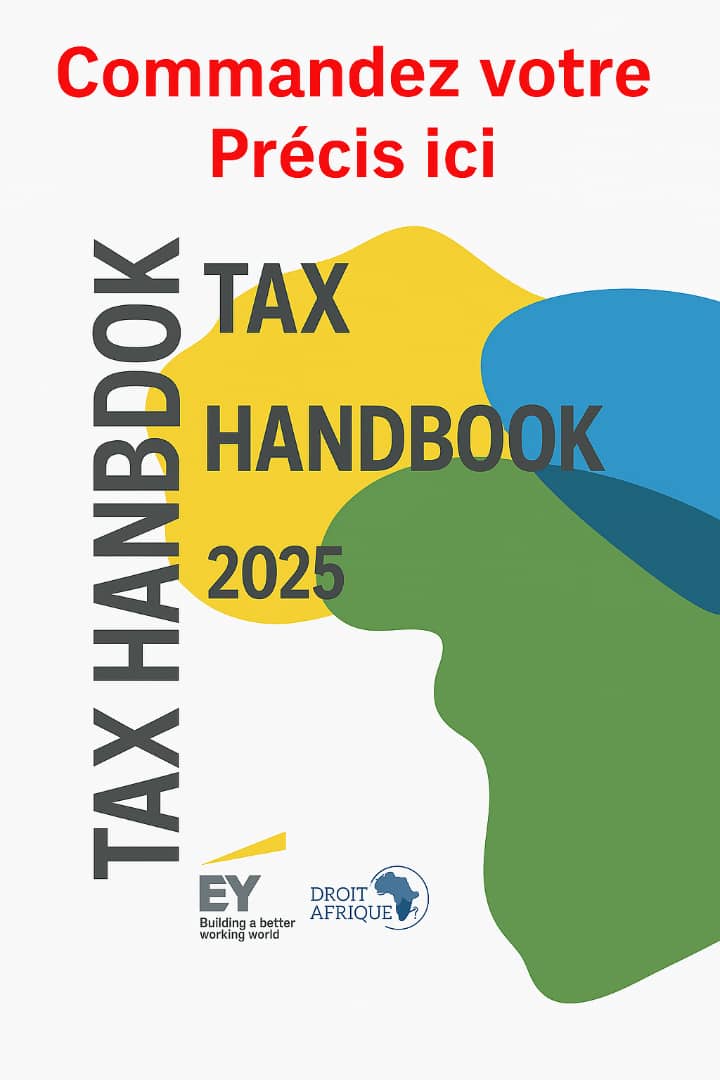Libreville, le 19 avril 2025 – (Dépêches 241). Dans un État de droit, refondé et restauré, les procès éclairent le droit. Dans d’autres, ils l’embarrassent. Le procès des Bongo-Valentin appartient malheureusement à la seconde catégorie. Celle où la justice, censée se fonder sur une mécanique juridique rigoureuse, semble parfois préférer l’apparence d’efficacité à la cohérence intellectuelle. Le procès Valentin met en exergue une tension essentielle du droit pénal : l’effritement du principe selon lequel l’action contre les complices ne peut avoir de cohérence que si l’auteur matériel de l’infraction est identifié, situé, et juridiquement appréhendé.
Depuis un siècle, tous les manuels de droit pénal enseignent la même évidence, l’auteur est celui qui pose l’acte matériel, celui dont le geste consomme l’infraction. La complicité n’est qu’un prolongement de cet acte. La doctrine conventionnelle définit l’auteur comme celui qui accomplit l’élément matériel de l’infraction, l’acte positif par lequel le comportement prohibé se réalise.
Dit autrement, est auteur celui qui exécute personnellement l’acte interdit par la loi pénale. Cet acte positif constitue l’élément matériel de l’infraction, lequel, selon la théorie tripartite ( élément légal, matériel, moral ), matérialise l’existence même du fait punissable. À l’inverse, le complice est défini comme accessoire et la complicité n’est punissable que si elle se rattache à « un crime ou un délit » effectivement et matériellement commis. En d’autre termes, la complicité n’a d’existence que par référence à l’infraction principale. Sans fait principal punissable, point de complicité possible. Or, dans l’affaire des Bongo-Valentin, la justice semble avoir pris la liberté de renverser ce principe : elle pourchasse l’ombre pendant que le corps reste immobile.
Dans ce procès, les déclarations de Mohamed Ali Saliou, ancien Directeur de Cabinet Adjoint d’Ali Bongo, replacent clairement Yann Koubdje, Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, au centre de l’acte matériel : « C’est le Directeur Général du Trésor qui décaissait les fonds », a-t-il indiqué à la Barre tout en précisant, « Je n’avais aucun pouvoir de décision sur l’utilisation de ces fonds ».
Toujours devant la Cour, l’ancien Directeur de Cabinet Adjoint d’Ali Bongo, a clairement rappelé qui, selon lui, accomplissait les actes matériels de décaissement. Il a indiqué, et ce point est crucial, que Yann Koubdje, alors patron de la Comptabilité Publique et du Trésor, était la personne qui décaissait effectivement les fonds au cœur de l’affaire. Une précision qui va directement au cœur de l’élément matériel de l’infraction.
Interrogé par un avocat de l’État au sujet des emprunts obligataires contractés par l’ancien Gouvernement, Mohamed Ali Saliou a répondu, non sans une pointe de fermeté : « Maître ici présent se trompe de personne à qui poser ces questions, car nous avons le ministre de l’Économie, le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, le Directeur Général du Budget, le Directeur Général de la Dette. Toutes ces personnes devaient être citées ici, car je n’avais aucun pouvoir de décision sur l’utilisation de ces fonds. »
Cette réponse, en apparence technique, constitue en réalité une invitation subtile adressée au parquet : s’intéresser aux auteurs principaux, ceux dont les responsabilités décisionnelles et opérationnelles étaient effectives, et non simplement présumées ou supposées. Car, un dispositif de poursuites visant exclusivement les receveurs, facilitateurs ou agents périphériques, sans viser l’ordonnateur opérationnel, constitue un déséquilibre conceptuel majeur. Un contresens juridique. Une anomalie méthodologique. Pire, un non-sens pénal.
Dans la même veine, Mohamed Ali Saliou a également souligné que Yann Koubdje aurait, selon ses déclarations, bénéficié des mêmes « largesses présidentielles » auxquelles les prévenus ont répondu devant la justice. À propos du bonus exceptionnel évoqué durant les débats, il a affirmé que l’ancien Président Ali Bongo avait demandé à Yann Koubdje de décaisser quatre milliards, dont deux milliards destinés à Yann Koubdje lui-même.
L’ancien Conseiller Spécial d’Oligui Nguema aurait donc été simultanément l’auteur matériel en décaissant les fonds, le bénéficiaire d’une partie des sommes, et un acteur doté d’un pouvoir d’ordonnancement ou d’exécution réelle. Ainsi, selon ces déclarations, celui qui ordonnait, décaissait, posait l’acte positif, et profiterait également de certains avantages financiers, se trouve aujourd’hui ni inquiété, ni interrogé, ni cité à comparaître alors que le procès s’achève. Or, en droit pénal, un principe fondamental rappelle : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »
Dès lors, comment justifier, sur le plan strictement juridique, que celui qui détient la compétence administrative, exécute l’acte positif, réalise matériellement le transfert des fonds et en tire un avantage personnel, ne soit ni entendu, ni inquiété, ni même cité ? À dire vrai, si on suit la logique juridique, celui qui exécute matériellement l’acte, en conscience, et en retire un bénéfice direct, ne peut être ignoré au profit exclusif de ceux à qui l’on attribue seulement un rôle secondaire.
Dès lors, une interrogation s’impose, simple, directe et pourtant vertigineuse : Au nom de quoi Mohamed Ali Saliou devrait-il être jugé pour des faits supposés de perception indue de fonds, de blanchiment de capitaux alors que Yann Koubdje, qui, selon plusieurs déclarations d’audience, a décaissé ces mêmes fonds et en aurait lui-même perçu une partie, demeure libre, absent des débats, et jamais entendu ?
Cette situation crée une ligne de fracture dans la cohérence même du procès. Elle entame la lisibilité des poursuites. Elle donne l’impression d’une justice qui, faute de pouvoir atteindre certaines responsabilités, se rabat sur les acteurs périphériques. Tout juriste ne peut qu’être interpellé par la question suivante : Comment juger pour perception indue des fonds ou blanchiment des capitaux un prévenu, si celui qui a matériellement procédé aux décaissements et aurait lui-même bénéficié des fonds demeure hors de toute poursuite ?
La doctrine pénale enseigne que le procès pénal doit reconstruire la chaîne logique des responsabilités, depuis l’acte matériel jusqu’aux bénéficiaires et facilitateurs. Dans un État de droit, l’architecture pénale repose sur un principe cardinal : l’auteur principal précède le complice, le fait principal commande l’accessoire. Lorsque cette hiérarchie est renversée, c’est la crédibilité même du procès qui s’en trouve altérée.
Le procès des Bingo-Valentin se retrouve ainsi au cœur d’un paradoxe : on juge les marges, mais on épargne le centre. Tant que les auteurs matériels, ceux qui ont posé les actes positifs, ne sont ni appelés, ni entendus, ni poursuivis, une zone d’ombre demeurera, et avec elle, le sentiment d’un procès incomplet, partiel, bancal. En laissant de côté l’ordonnateur présumé, ledit procès paraît se priver de son point d’ancrage juridique essentiel : l’auteur matériel. La poursuite devient alors asymétrique, affaiblie, voire bancale. Pradel résume cette exigence avec gravité : « Le droit pénal ne peut frapper l’ombre et épargner le corps »